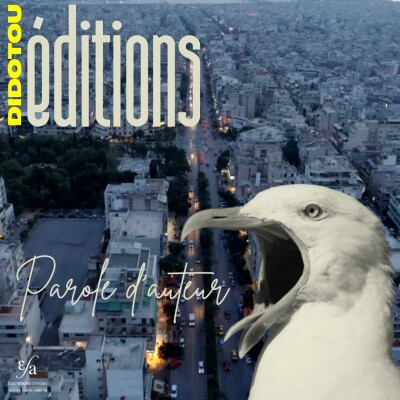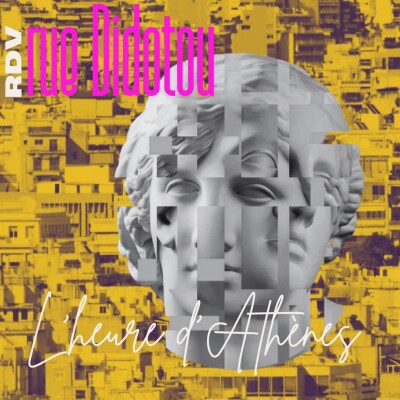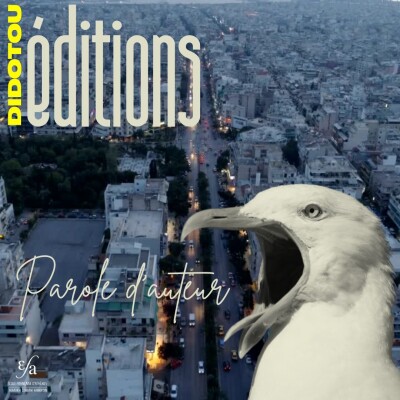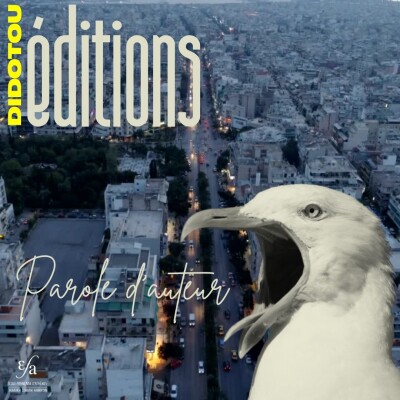Speaker #0Bonjour à toutes et à tous. Je suis Dominique Moreau, maître de conférences en Antiquité tardive à l'Université de Lille et membre permanent de l'unité mixte de recherche Histoire, Archéologie, Littérature des Mondes Anciens, aussi connue sous l'acronyme HALMA-UMR 8164. Je suis spécialiste d'histoire et d'archéologie du monde romain tardif, intéressé notamment par les relations entre l'État romain et la religion chrétienne, entre autres par l'impact de cette dernière sur les formes et fonctions urbaines, en particulier dans le monde balkanique oriental. Dès mon recrutement à l'Université de Lille en 2014, j'ai commencé à développer un projet sur la christianisation de la région, connu aujourd'hui sous le nom de DANUBIUS. Financé entre 2018 et 2022 à la fois par l'Agence nationale de la recherche et par l'Initiative d'Excellence de l'Université de Lille, ce même projet a donné lieu à divers résultats directs et indirects, parmi lesquels la création de la collection « Rome and After in Central and Eastern Europe » chez Brepols Publishers, qui est dédiée à la présence romaine en Europe centrale et orientale, ainsi que la mise en place d'un réseau international de recherche consacré à l'histoire et à l'archéologie dans les Balkans romains tardifs, dont je suis le coordinateur, le réseau HAEMUS. Les fondements de ce dernier ont été posés à l'occasion d'une réunion organisée en marge de la première école d'été du projet DANUBIUS, qui s'est tenue du 12 au 14 septembre 2019, sur le thème de l'archéologie des Balkans tardos antiques. Les intervenants de cette activité, centrés autour de missions archéologiques internationales impliquant la France, sur l'archipel de Kvarner en Croatie, dans la vallée du Drin en Albanie, à Caričin Grad en Serbie, à Ulpiana au Kosovo et à Zaldapa en Bulgarie, ont convenu, à l'issue d'une séance de discussion à huis clos, qu'il était nécessaire de renforcer toute forme de collaboration entre les différentes équipes sur le terrain, en s'inspirant directement d'expériences passées allant en ce sens, notamment les groupes de recherche 924 et 1052 du Centre national de la recherche scientifique, qui ont été dirigés successivement par Noël Duval, Pierre Cabanes et Jean-Luc Lamboley, et qui se sont concentrés, de 1988 à 2000, sur l'Ex-Yougoslavie et sur l'Albanie. La nouvelle initiative devait toutefois étendre le champ d'activité à l'ensemble des Balkans, tout en dépassant le cadre des seules relations internationales de la France. Les participants à cette séance à huis clos s'entendirent alors pour rallier le maximum de chercheurs et pour identifier les institutions clés qui pourraient porter l'entreprise, avec pour objectif de répondre à des appels à projets au niveau national et européen. Il ne portait pas encore son nom, mais le Réseau international de recherche HAEMUS venait de naître. Après un peu moins de deux ans de travail, le réseau fut officiellement lancé en ligne le 18 juin 2021 devant un auditoire virtuel composé d'une soixantaine de personnes. L'activité s'est déclinée en deux moments. D'une part, une présentation du projet par deux de ses porteurs, Christophe Goddard et moi-même. D'autre part, une grande conférence sur l'histoire des travaux archéologiques menée sur le site de Caričin Grad par Vujadin Ivanišević et Catherine Vanderheyde. Cette deuxième partie inaugura également ce qui est devenu aujourd'hui une activité pérenne du réseau, soit sa Online Guest Lecture Series, qui a proposé le 7 juillet dernier sa 30e conférence. L'impact de l'événement et de la publicité qui s'en suivit immédiatement sur les réseaux sociaux, a été tel que la liste de diffusion est rapidement passée, en l'espace de quelques jours, d'une petite centaine d'adresses électroniques, toutes empruntées à des connaissances personnelles des membres du comité de pilotage, a un peu plus de 300 inscriptions. Aujourd'hui, cette même liste inclut plus de 420 chercheurs et étudiants à travers le monde, ce qui n'en fait rien de moins que le plus grand réseau international de recherche sur l'archéologie et l'histoire des Balkans. Géré par un comité de pilotage rassemblant les représentants de 28 institutions en Europe, parmi lesquelles l'École française d'Athènes, HAEMUS est depuis sa création, à l'origine de très nombreuses initiatives, notamment le lancement en janvier 2023 d'un cercle de jeunes chercheuses et de jeunes chercheurs qui organisent une journée d'études annuelle en ligne à l'automne, ainsi qu'un grand workshop international sous le format d'un congrès dont la première édition se tint à Villeneuve d’Ascq et à Lille du 10 au 12 novembre 2021. Le livre issu de cette manifestation est actuellement sous presse et la deuxième édition est prévue à Belgrade à la fin du printemps 2026. Parmi les autres initiatives, qui est, dans ce cas précis, totalement attribuable aux éditions de l'EFA, mentionnons le lancement récent d'une revue intitulée « The Chronicles of Haemus » abrégée « CoH ». Inaugurées officiellement le 1er janvier 2025, mais ouvert au public en mai de la même année, les CoH s'inscrivent dans une démarche scientifique inédite qui vise à offrir, pour la première fois, une publication périodique à comité de lecture, en ligne et en accès ouvert, pour l'ensemble des chercheuses et des chercheurs spécialisés dans l'étude des Balkans et des territoires environnants, cela pendant les périodes tardo-romaines et proto-byzantines. Portée pleinement par le réseau HAEMUS, cette initiative vise à combler un vide dans les études académiques, en créant un espace unique de collaboration interdisciplinaire et transnationale. Se concentrant sur la période allant du IIIe au VIIIe siècle après Jésus-Christ, période qui est marquée par des transformations profondes, tant politiques que culturelles, les CoH proposent d'explorer des thèmes variés, de la transition de l'autorité romaine à l'implantation des royaumes barbares, des mutations urbaines et économiques à l'évolution des pratiques culturelles et religieuses. En publiant dans les principales langues d'Europe occidentale, non seulement en anglais, mais aussi en français, en italien, en allemand et en espagnol, la revue constitue une plateforme accessible pour la recherche innovante. Les CoH ont ainsi pour ambition de devenir une référence incontournable dans les études balkaniques. Pour les chercheurs, les enseignants, les étudiants et les passionnés d'histoire et d'archéologie, en offrant une tribune aux recherches innovantes ou à des comptes rendus critiques longs. Donc, elle ambitionne de devenir le périodique électronique par excellence pour l'archéologie et l'histoire de la péninsule balkanique dans l'Antiquité tardive. À ce jour, deux articles importants, issus de deux conférences en ligne du réseau, ont été publiés. Soit un article de James Crow, professeur émérite à l'Université d'Édimbourg, sur le mur d'Anastase, et un article de Carla Sfameni, Lucia Alberti et Francesca Colosi, chercheuses au CNR italien, ainsi que de Tatiana Koprivica et Olga Perlcer-Vujačić, de l'Université du Monténégro, sur le site Doclea. La revue faisant l'objet d'un appel à contribution annuel permanent, de nouvelles études viendront s'ajouter dans les semaines à venir et démontreront tout l'intérêt de cette initiative. À travers une approche rigoureuse et diversifiée, les CoH aspirent à faire progresser les connaissances sur une région et une période souvent considérées à tort comme marginales dans l'histoire européenne. En vous invitant chaleureusement à nous envoyer vos manuscrits sur l'archéologie et l'histoire des Balkans dans l'Antiquité tardive et en vous invitant à rejoindre la liste de diffusion du Réseau international de recherche HAEMUS. Je vous remercie de votre attention.