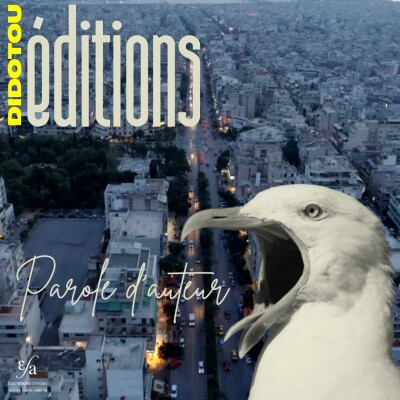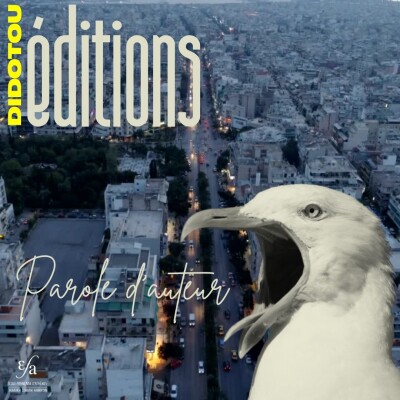Speaker #0Bonjour, je m'appelle Laureline Pop. Je suis archéologue et historienne de l'Antiquité, spécialisée dans la sculpture grecque et l'histoire sociale des époques hellénistiques et impériales. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler de mon livre « Les statues-portraits, miroirs des transformations sociales, Athènes et Délos du IIIe siècle avant Jésus-Christ au IIe siècle après J.-C. ». Ce livre est le fruit de plusieurs années de recherche menées dans le cadre de ma thèse de doctorat, soutenue en 2023 à l'Université de Lausanne, sous la direction de Karl Reber et Anne Bielman. Il vient tout juste de paraître en coédition entre l'École française d'Athènes, dont je suis membre suisse, et les éditions Alphil presse universitaire suisse. Alors, que sont exactement ces statues-portraits ? Imaginez un monument composé de trois éléments, une base, une inscription, et une statue représentant une personne réelle, souvent honorée de son vivant ou peu après sa mort. Ce sont ces inscriptions gravées sur les bases qui ont été au cœur de ma recherche. Pourquoi ? Parce qu'elles nous livrent de précieuses informations que je vais vous présenter à travers un exemple concret. Nous pouvons prendre comme exemple une base découverte à Délos datée du début du 1er siècle avant Jésus-Christ. Sur cette base, une inscription est gravée et on peut y lire : « Les Athéniens, les Romains, et les autres grecs qui sont établis à Délos, ainsi que les commerçants et les nauclères qui y débarquent, ont érigé la statue d'Aropos, fils de Léon, du dème Azénia, qui a été épimélète de Délos. Pour sa valeur, son équité et sa piété. À Apollon, à Artemis et à Létô. Agasias, fils de Ménophilos, éphésien, a fait la statue ». Grâce à cette inscription, nous savons qui était représenté par la statue. Statue qui, elle, n'est malheureusement pas conservée. La base sur laquelle est gravée l'inscription nous permet en revanche de savoir qu'il s'agissait d'une statue en bronze. Elle représentait donc Aropos, en athénien, fils de Léon du dème d'Azénia. Il est d'usage dans certaines inscriptions de donner en plus du nom de la personne, le nom du père ainsi que l'origine. Les dèmes sont les circonscriptions administratives d'Athènes, un peu comme nos arrondissements d'aujourd'hui. Nous apprenons également qu'Aropos a occupé une fonction officielle à Délos puisqu'il en a été l'épimélète, soit le premier magistrat. À cette époque, Délos est sous tutelle athénienne et c'est pour cela qu'un athénien occupe la plus haute magistrature. L'inscription précise en outre que c'est en raison de sa valeur, de son équité et de sa piété qu'il s'est vu offrir une statue. Les vertus énumérées dans les inscriptions sont plutôt homogènes et répétitives. Elles fournissent de cette manière un modèle à suivre. Maintenant qu'Aropos est un peu mieux identifié, attardons-nous sur les autres personnes mentionnées par l'inscription. Elle évoque les Athéniens, les Romains et les autres Grecs établis à Délos, ainsi que les commerçants et les nauclères, c'est-à-dire les propriétaires de bateaux marchands qui y débarquent. Comme mentionné, l'île de Délos est à cette période sous tutelle d'Athènes et cela par l'intervention de Rome. En 167 avant Jésus-Christ, le Sénat romain livre l'île aux Athéniens et lui octroie le statut de port franc. Ce statut de port franc fait de Délos un carrefour commercial majeur en Méditerranée. L'île devient un point de passage clé entre l'Occident et l'Orient. La communauté cosmopolite qui remercie Aropos est composée à la fois d'Athéniens, de Romains et d'autres Grecs vivant dans l'île, mais également de commerçants de passage. Ajoutons que la statue est dédiée à ce que nous appelons la triade apollinienne, Apollon, Artemis et Létô. Délos accueille en effet le grand sanctuaire panhellénique d'Apollon, et ce dernier est très fréquemment la divinité récipiendaire de ce type de monument. Enfin, la dernière ligne de l'inscription nous renseigne sur le sculpteur qui a effectué la statue, Agasias, en éphésien, qui est très actif à Délos durant cette période et qui signe plusieurs statues érigées dans l'île. Ce type de document révèle bien plus qu'une identité. Il témoigne de la diversité sociale, des pratiques honorifiques et du contexte politique. Dès l'époque archaïque, des effigies sont érigées à titre privé pour figurer certains membres prestigieux des cités grecques, et cela tant dans les sanctuaires que dans les nécropoles. Au cours du IVe siècle avant Jésus-Christ, en parallèle du développement du système civique, les autorités des cités commencent à offrir des statuts en remerciement d'actions particulières. Ces phénomènes prennent une ampleur considérable durant l'époque hellénistique, qui est marquée par l'instauration progressive de nouveaux royaumes. Les rois et les reines figurent d'ailleurs parmi les principaux bénéficiaires de monuments statuaires. À l'époque impériale, ces monuments se perpétuent malgré de nouveaux changements institutionnels. Comme vous le comprenez, ces représentations ont une très longue histoire. Dans cette recherche, je me suis concentrée sur la période entre 322 avant Jésus-Christ, qui correspond au début de l'époque hellénistique, et 192 après Jésus-Christ, soit la chute de la dynastie des Autonins. Cette date marque pour certains historiens le début de la période dite du Bas-Empire. Mon étude s'est focalisée sur plusieurs questions. Comment construit-on l'image de l'individu ? Qui est représenté par ses statues ? Comment et pourquoi les représente-t-on ? L'étude de telles œuvres permet de traiter à la fois la question de la représentation individuelle, mais aussi de son cadre institutionnel et social. Or, à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, les représentations sont marquées par des changements notables dans le traitement du visage. Alors qu'auparavant les visages des statues ne semblaient que peu caractérisés, à partir de cette date, ils semblent devenir un enjeu clé de la représentation. Les rides, la calvitie, les oreilles décollées, mais aussi une certaine mollesse dans les chairs, singularisent les portraits à partir de cette époque. Si cette problématique me semblait évidente et a constitué mon point de départ, cette étude a ouvert la porte à un questionnement bien plus vaste. Mon intérêt s'est rapidement tourné vers le site de Délos. Ce dernier a conservé une très grande quantité de sculptures en marbre, dont de nombreux portraits, aux traits caractérisés, ainsi qu'un riche corpus épigraphique. À cela s'ajoute le fait que sa chronologie est relativement bien connue. Sous la tutelle des Athéniens, l'île de Délos devient l'un des grands centres économiques méditerranéens. L'île gagne dès lors en importance et attire une population cosmopolite. Par la suite, elle connaît en revanche deux attaques très violentes, en 808 avant Jésus-Christ et en 69 avant J.-C., on a ainsi quelques repères chronologiques fixes pour ce site. L'étude de la cité d'Athènes comme second site s'est imposée naturellement, d'abord parce qu'elle exerçait une tutelle sur Délos, mais aussi pour d'autres raisons. Athènes livre en effet un très riche matériel épigraphique et statuaire. De plus, c'est l'un des lieux qui a vu naître la statuaire honorifique. Le groupe statuaire d’Harmodios et d’Aristogeiton, installé sur l'agora d'Athènes, peu après 514 avant J.-C., est considéré comme la première effigie de ce type. Cependant, ce groupe érigé pour les deux assassins du tyran Hipparque exprime plus l'exaltation d'un archéthique, du bon citoyen, qu'une réelle représentation honorifique. D'un point de vue chronologique, l'analyse conjointe d'Athènes et de Délos offre l'avantage d'être complémentaire. Alors que Délos perd peu à peu son attractivité à partir du Ier siècle avant J.-C., Athènes connaît un regain d'activité à l'époque impériale, notamment grâce à certains empereurs philhellènes. En outre, ces deux sites présentent l'intérêt d'être très bien documentés. Aborder plusieurs disciplines de la recherche a été l'une des principales difficultés que j'ai rencontrées dans cette étude. Traditionnellement, l'étude de la statuaire a été abordée par les archéologues et historiens de l'art sous le prisme de l'objet d'art. Les historiens et épigraphistes ont, quant à eux, concentré leur analyse sur l'histoire de la sculpture, s’appuyant en grande partie sur les sources littéraires et épigraphiques. Deux ouvrages ont été fondamentaux et très inspirants dans la recherche que j'ai menée. Ce sont les études de John Ma sur les formulaires épigraphiques des bases de statut et de Guillaume Biard sur la représentation honorifique, édité par l'École française d'Athènes. Ils ont tous deux démontré l'intérêt d'étudier ces monuments par des approches interdisciplinaires. Une autre influence majeure de mon approche se trouve dans la définition même du sujet. Le mot « portrait » pose un véritable problème terminologique. De nombreux archéologues et historiens de l'art le rejettent entièrement, le jugeant inapproprié à la sculpture grecque. Même lorsqu'il n'est pas rejeté, la problématique de la définition de ce terme demeure. Il n'existe pas de terme exact correspondant à la notion moderne de portrait. Pourtant, ces statues érigées pour honorer un individu ou marquer sa tombe entendent bien figurer ce dernier. Cette volonté est au demeurant explicite dans les inscriptions, ce qui justifie, selon moi, l'utilisation du mot « portrait » dans cette recherche. Les différents termes utilisés dans les textes grecs ont cependant été repris et développés en détail dans cet ouvrage, afin d'explorer les contours et la terminologie de la représentation individuelle. La première étape de ce travail a été l'établissement du corpus d'études. Il s'est agi de répertorier, à partir des données déjà publiées d'une part les bases de statues et de l'autre les fragments statuaires. Et là encore, chaque type de matériel présentait ses propres difficultés. L'étude iconographique se heurte par exemple à l'absence presque totale des statues en bronze, et cela alors que les bases attestent largement de leur prééminence. Il est en outre souvent difficile d'identifier ces statues comme des portraits. Les types statuaires peuvent être ambigus, puisqu'inspirés de l'iconographie des divinités. A l'époque hellénistique, on constate plusieurs tendances. Dans les contextes de sanctuaires, les officiants de culte peuvent se parer de certains attributs appartenant à la divinité. En parallèle, il est de plus en plus fréquent que les statues de rois et de reines reprennent certains codes iconographiques appartenant traditionnellement aux divinités. Dès lors, comment distinguer la statue d'un individu et celle d'une divinité ? La mise en place de critères de sélection a été nécessaire pour élaborer le corpus. L'étude des types statuaires montre que le champ iconographique demeure relativement limité. Le répertoire principal de ce type de monument est représenté par des statues debout, généralement drapées. Ce phénomène a été mis en lien avec le développement de l'évergétisme dans les cités. L'évergétisme désigne une forme particulière de générosité pratiquée par les notables dans les cités grecques qui consiste à financer des bâtiments ou des événements publics. D'une certaine façon, les bienfaiteurs se distinguent dans la répétition et la reproduction de valeurs communes. Autant de valeurs qui sont, comme je l'ai mentionné, largement mises en avant dans les inscriptions gravées sur les bases de statut. Au total, 1060 monuments ont été répertoriés, soit 451 pour Délos et 609 pour Athènes. Chaque monument a été classé selon son contexte d'exposition. Grâce à la mise en série, cette façon de procéder permet dans de nombreux cas de recontextualiser des monuments dont la provenance exacte demeure sujette à caution. On trouve ce type de statues aussi bien dans les grands sanctuaires que dans d'autres lieux de culte. Mais ce sont bien les sanctuaires principaux qui restent à Délos comme à Athènes. les espaces d'exposition privilégiés. On en trouve aussi sur les agoras et dans des bâtiments publics, comme les gymnases ou les théâtres. D'autres lieux peuvent les accueillir, comme les sièges d'associations, les nécropoles et, dans certains cas, même des maisons privées. Le cas le plus connu est sans conteste le monument dit de Kléopatra. Peu après 138 avant Jésus-Christ, Kléopatra, une riche athénienne, fait en effet ériger au cœur de sa maison sur l'île de Délos sa statue et celle de son époux. Dans les grandes lignes, ce que nous pouvons désigner comme des stratégies d'occupation de l'espace reste assez semblable au fil des siècles dans les cités étudiées. Mais la comparaison permet de faire ressortir de subtiles différences qui reflètent les contextes politiques propres à chacun. Sur l'île de Délos, qui n'est plus une cité libre dès 167 avant Jésus-Christ, les espaces civiques sont nettement moins attractifs qu'à Athènes au cours de la même période. Le peuple des Athéniens privilégie en effet les espaces civiques de sa propre cité pour remercier ses bienfaiteurs. Ces nuances éclairent également ce que Guillaume Biard formulait déjà dans sa conclusion. Si le type des statues honorifiques est en genre qui peut prendre des formes multiples et qui se retrouve dans toute la culture grecque, il dénote également des caractéristiques propres à chaque cité. À Délos, on assiste à partir du Ier siècle avant Jésus-Christ à une chute drastique du nombre d'effigies individuelles mais également à une très forte diminution des lieux d'exposition de ces effigies. Le sanctuaire d'Apollon et principalement la zone immédiate autour des temples finissent par être les derniers espaces à accueillir des statues portraits. En revanche, à Athènes, malgré les changements politiques, les espaces publics civiques continuent d'accueillir de nouveaux monuments. On constate même une augmentation croissante depuis les IIIe siècle avant J.-C. au IIe siècle après J.-C. L'étude a également permis de confirmer l'émergence et surtout la surreprésentation des notables au cours de l'époque hellénistique. Leurs influences grandissantes étant des faits des plus remarquables. Ils occupent une place politique et physique croissante et les effigies individuelles en sont dans des témoignages les plus explicites. Les représentés sont principalement les citoyens utiles et productifs. Notons toutefois que l'entourage de ce citoyen bénéficient également du système mis en place. Les dédicants et les représentés sont très souvent semblables puisque la cité est ses membres qui érigent des statuts. Ces citoyens utiles constituent un groupe restreint et relativement homogène. Mais ce n'est pas seulement le groupe qui est homogène. Il a été démontré que malgré les divers changements institutionnels, le langage utilisé par les bases, les statuts et les formulaires épigraphiques étaient lui aussi homogènes. Quelles que soient les personnes ou les instances qui érigent des statuts portraits, les codes demeurent similaires, se calquant sur les pratiques des instances civiques principales. La répétition de certaines valeurs relève d'une stratégie de communication. Le rapport social établi par le système honorifique tend ainsi à l'émulation entre les citoyens, en mettant en avant des valeurs propres à la communauté de la cité. Ces monuments statuaires sont de fait des vecteurs de communication importants. Cependant, le genre même du portrait est un genre équivoque qui dépend en très grande partie de la façon dont est pensé et présenté l'individu au sein d'une société particulière ayant ses propres codes. Or, la période étudiée voit tout un faisceau de phénomènes et de dynamiques qui contribuent fortement au développement et au renouvellement de l'art du portrait, alors que les bases et leurs formulaires épigraphiques semblent rester en grande partie conditionnées par le système honorifique et la volonté d'afficher l'exemplarité du citoyen grec, véhiculant ainsi des codes communs à la cité, traduit iconographiquement par les corps statuaires drapés et presque figés, les visages pourraient être le moyen d'expression de l'individualité de la personne représentée. La statuaire, comprenant ici à la fois la statue mais aussi sa base, offre ainsi au regard tout un cortège d'éléments signifiants. L'inscription donne le nom de la personne figurée, tout comme la statue présente l'individu à travers son visage. S'il est évidemment très intéressant de connaître les noms des individus, derrière les portraits de marbre ou de bronze, ces monuments statuaires sont également le reflet d'une société cosmopolite et mouvante. Et c'est ce point crucial que j'ai tenu à souligner par le choix du titre de l'ouvrage. L'approche croisée, abordant les aspects techniques, la matérialité des objets, la typologie de la statuaire ou les formulaires épigraphiques, a permis d'examiner dans un temps long un phénomène social de grande ampleur. En définitif, ces monuments nous racontent certes des histoires individuelles, mais il révèle aussi combien l'art du portrait est indissociable des transformations politiques et sociales. Mais ce qui me frappe le plus, c'est la modernité de ces préoccupations. Aujourd'hui encore, nous nous interrogeons sur la manière de nous représenter, sur l'image que nous voulons donner de nous-mêmes, et sur les valeurs que nous voulons mettre en avant.