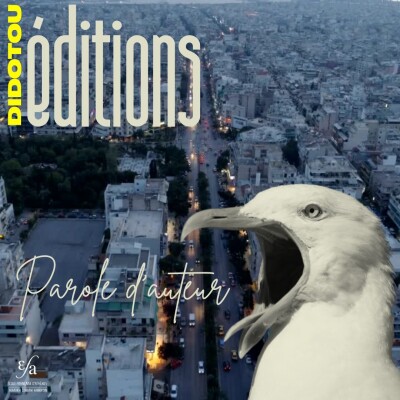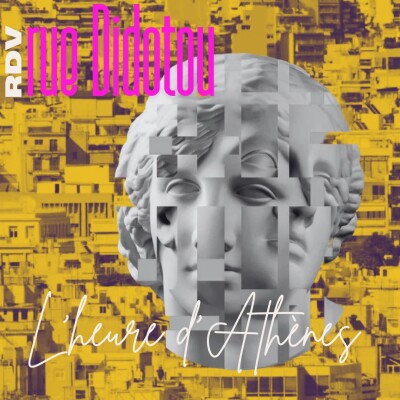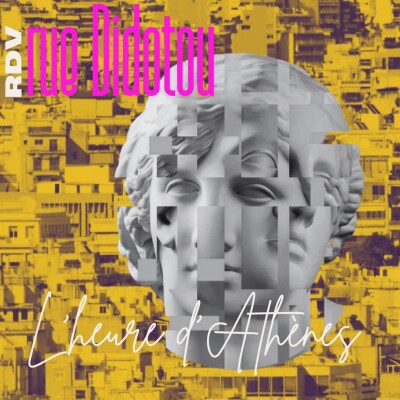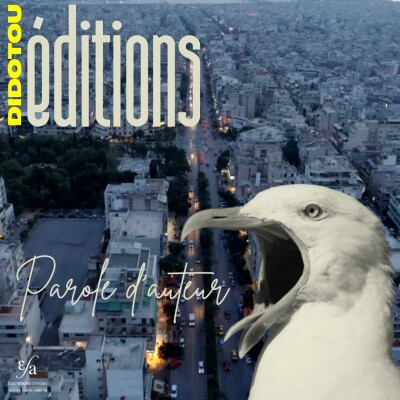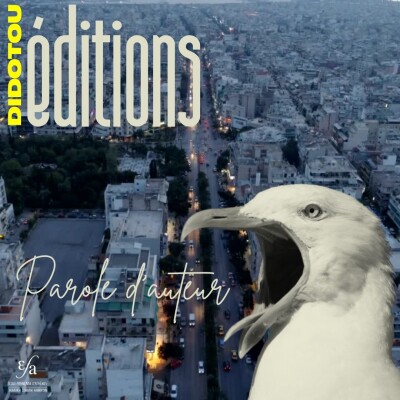Speaker #0Bonjour, je m'appelle Thierry Lucas, je suis docteur en archéologie de l'Université Paris 1, et je vais vous présenter mon ouvrage « L'organisation militaire de la Confédération béotienne de 447 à 171 avant Jésus-Christ » . Ce livre est le résultat de mes recherches de doctorat, commencées il y a maintenant dix ans. Il a été publié en 2023 dans la collection de la BEFAR, et j'ai eu la chance de recevoir pour ce travail deux prix, celui de l'Association des études grecques et le prix Ambatiélos de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres. Dans ce travail, j'ai voulu étudier une thématique centrale en histoire grecque, l'impact de la guerre sur la société. Tout l'enjeu est de savoir comment dans une société donnée, on se prépare à la guerre. Comment on cherche à l'anticiper, à la conduire, à l'éviter ou à la tenir à distance ? Et comment cette société en vient à intégrer la guerre dans ses institutions politiques, dans ses représentations et dans sa culture ? J'ai appliqué ce filtre de lecture à une région, la Béotie. Plusieurs raisons m'ont poussé à ce choix. Tout d'abord, il s'agit d'une région dotée, au sein du monde grec, d'une identité culturelle forte, qui s'est traduite, dès le VIe siècle avant Jésus-Christ, par la mise en place d'un système fédéral, pour regrouper les cités béotiennes. Les plus importantes sont Thèbes, Tanagra, Thespies ou Orchomène, mais il y a aussi une dizaine d'autres cités plus petites. C'est donc une région qui forme un ensemble culturel cohérent, perçu comme tel dès l'Antiquité, et les Béotiens ont été les tout premiers. à concrétiser cette identité culturelle commune à un niveau politique en mettant en place des institutions fédérales. En second lieu, la Béotie a été au cœur des grands événements militaires des époques classiques et hellénistiques. Thèbes a même connu une période d'hégémonie au IVe siècle durant laquelle elle a joué un rôle de premier plan dans le monde grec. C'est donc une région qui offre l'occasion, en quelque sorte, de revisiter toute l'histoire grecque sous un prisme différent de celui d'Athènes, de Sparte ou des grands royaumes hellénistiques. Enfin, grâce aux recherches anciennes et récentes dans la région, j'ai pu appuyer mon enquête sur une grande variété de sources. Des textes historiques pour la période classique, des inscriptions pour l'époque hellénistique, complétées par l'analyse des fortifications des cités béotiennes ou encore des représentations sur les stèles funéraires ou sur les vases à figure rouge de la région. Jusqu'ici, il n'y avait pas eu d'études spécialement sur le point militaire, sur le temps long, mais mon livre s'inscrit en fait dans un contexte assez favorable pour l'étude d'une région qu'on connaît de mieux en mieux grâce à de nombreuses études récentes dont j'ai pu bénéficier, comme celle de Denis Knoepfler ou de Yannis Kalliontzis. Il m'a paru important de mener cette étude sur le long terme en incluant à la fois l'époque classique et l'époque hellénistique. Pour l'époque classique, les sources sont plus ténues, Et il faut faire face à ce qu'on pourrait appeler un « mirage thébain » puisque la plupart des textes qui parlent de la période de grandeur de la Béotie au IVe siècle se concentrent uniquement, de façon quasi-agiographique, sur les figures des grands généraux thébains de cette époque, Epaminondas et Pélopidas. Pour mon enquête, je suis parti d'abord de l'échelle politique, la façon dont les Béotiens ont su, dès l'époque classique, s'associer et former un État fédéral remarquablement équilibré. C'est la première constitution représentative qu'on connaisse. Bien sûr, dans ce processus, les questions militaires ont joué un rôle primordial. Dès l'origine, une des fonctions essentielles de cette organisation fédérale a été de répartir de façon égalitaire l'effort militaire sur les différentes cités. J'ai donc retracé les évolutions de ce système sur le temps long, depuis les premiers éléments attestés au VIe siècle, jusqu'à la dissolution de la Confédération béotienne par les Romains, en 171 avant Jésus-Christ. On observe une constante dans l'organisation politique, la tendance à regrouper les cités au sein de districts fédéraux pour répartir l’effort militaires de façon équitable. Ces districts étaient au nombre de 11 jusqu'au début du IVe siècle, puis de 7 à partir de 378. Chaque cité était ainsi représentée au sein des instances fédérales de façon proportionnelle à sa taille. Les plus grandes cités, comme Thèbes, représentaient un district à elles seules, alors que les cités plus petites étaient associées à plusieurs pour former un ensemble équivalent. Ce système devait permettre de recruter l'armée. C'est un mécanisme qui est particulièrement bien connu à l'époque hellénistique, pour lequel on a de nombreux indices qui montrent que les unités militaires étaient constituées par district. On a donc une première échelle d'organisation militaire au sein de la Confédération béotienne, qui est l'existence même de cette instance fédérale. Une fois la question traitée à l'échelle politique, je me suis tourné vers la dimension spatiale, le territoire, en analysant les fortifications des cités béotiennes, mais aussi le réseau de forts ou de tours qui jalonnaient les points cruciaux du territoire. On peut parler, à l'échelle de la région, d'un véritable paysage fortifié. Sur cet aspect, il est difficile de déceler concrètement l'influence fédérale, mais on a de bons indices qui montrent qu'à partir de la fin du IVe siècle au moins, on a un style de fortification homogène qui fait son apparition dans la région. Toutes les cités sont alors lourdement fortifiées. Le peu d'indices qu'on ait montrent que la Confédération béotienne a sans doute joué un rôle dans ce processus. Pour les postes secondaires, il existe notamment un type de tour spécifique à la région à partir du IVe siècle qui montre une forme de standardisation. Après l'échelon politique et l'échelon territorial, enfin, je me suis penché sur les hommes. Qui étaient les hommes qui combattaient dans l'armée fédérale ? Comment ils étaient équipés, armés, organisés ? Cela passe d'abord par une analyse des textes historiques qui mettent en scène l'armée fédérale. Par exemple, chez Thucydide ou Xénophon, dans le contexte de l'évolution du modèle grec de la guerre, à partir de la guerre du Péloponnèse. De ce point de vue, l'armée fédérale béotienne a été à la pointe des innovations du IVe siècle et s'est distinguée lors de batailles célèbres comme Leuctres, Mantinée ou Chéronée. Ses chefs les plus célèbres, Epaminondas et Pélopidas, sont représentatifs d'un milieu militaire particulièrement actif, formant une véritable école béotienne de tactique à l'époque classique. Pour l'époque hellénistique, cette armée évolue et la Confédération béotienne cherche à s'adapter aux nouvelles réalités imposées par les armées royales hellénistiques. On connaît moins bien les actions concrètes de l'armée fédérale, qui passe au second plan sur la scène internationale, mais on a en revanche des informations très précises sur les rouages internes de l'armée. On passe alors d'un recrutement censitaire à une armée de conscription, avec un service militaire, l'éphébie, calqué sur le modèle athénien, qui concerne tous les citoyens de leurs 18 ans à leurs 20 ans. Ce service se concrétise par l'inscription des jeunes gens, chaque année, sur des listes dressées par cité pour recenser chaque classe d'âge. Elles sont gravées sur des stèles ou directement sur des murs, voire sur des monuments. Ce processus est bien attesté dans la plupart des cités béotiennes, y compris dans de petites cités qui ne diront sans doute rien à nos auditeurs, comme Chorsiai, Hyettos ou Akraiphia. Grâce à ces listes, On arrive même à suivre des familles sur deux ou trois générations. Personnellement, je trouve que c'est un témoignage archéologique assez émouvant d'avoir ainsi des noms, des personnes, dont l'existence est cristallisée dans l'une des étapes essentielles de leur vie de citoyen. Vers 230 avant Jésus-Christ, l'armée s'aligne sur les standards royaux avec l'adoption de la phalange macédonienne et l'apparition d'unités d'élite calquées sur le modèle antigonide. Enfin, Dans une dernière partie, j'ai cherché à montrer comment l'expérience de la guerre a contribué à façonner les identités au sein de la région. Cela passe par une visibilité très importante du phénomène guerrier dans la société. Au Vème siècle, l'une des formes normales de l'héroïsation des défunts, dans un contexte de conflit avec Athènes, est de représenter le mort comme un guerrier, en cavalier ou en fantassin. Il se développe même un style régional propre sur les stèles funéraires ou sur les vases. À cette époque, le citoyen idéal est donc avant tout un guerrier. Au IVe siècle, ce type de représentation laisse la place à une représentation du défunt comme athlète, en nudité héroïque, mais il ne faut pas s'y tromper. À cette époque, le gymnase dans la société béotienne gagne en importance et devient le lieu par excellence de l'entraînement militaire. Sa fréquentation indique le statut de citoyen-soldat. Il s'agit donc essentiellement d'un autre langage pour signifier la même chose. Les défunts sont présentés comme des citoyens modèles, prêts à défendre leur cité. Par exemple, les morts du bataillon sacré tués lors de la bataille de Chéronée et ensevelis dans une tombe collective à proximité du champ de bataille ont été enterrés avec des strigiles, un instrument associé à la pratique du sport au sein du gymnase. On a donc choisi de les représenter comme des athlètes plutôt que comme des soldats. Cette part de la vie militaire dans la culture de la région rejaillit enfin sur les stéréotypes associés à la Béotie. On passe donc de l'histoire objective, celle des hommes, à l'histoire des représentations. En particulier, pour parler des Béotiens, on a beaucoup de textes antiques qui recourent à ce qu'on appelle le topos littéraire du cochon béotien, c'est-à-dire que les habitants de la région sont vus comme mal dégrossis. C'est d'ailleurs ce qui a donné l'expression « béotien » qu'on utilise encore en français. Ce stéréotype a des implications dans le domaine militaire. Spécifiquement, il implique que les béotiens s'occupent plus de leur corps que de leur esprit, passent trop de temps au gymnase, mangent comme des athlètes, c'est-à-dire beaucoup, et ont donc une réputation de brutes épaisses. Beaucoup de textes utilisent ainsi explicitement ce stéréotype pour expliquer les succès militaires des béotiens, et même pour parler de personnages célèbres comme Epaminondas.