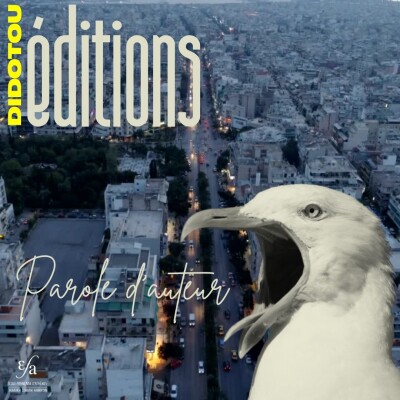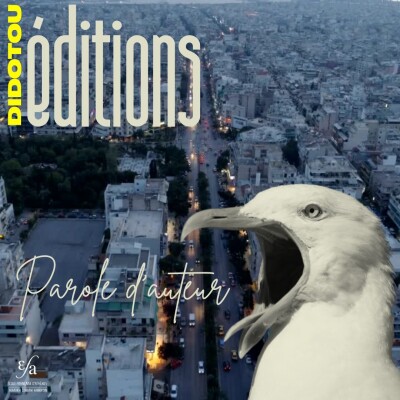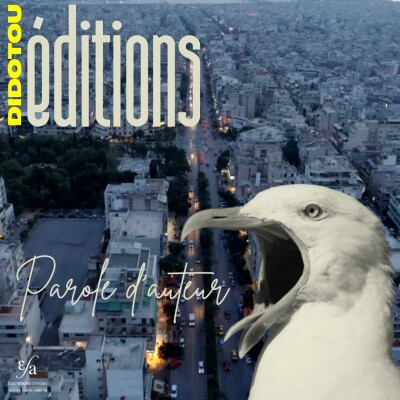Speaker #0Bonjour, je m'appelle Maria Noussis, je suis membre de l'École française d'Athènes et je vous emmène aujourd'hui au cœur d'une enquête passionnante qui commence dans les caves dédaleuses du Palais universitaire de Strasbourg. L'ouvrage présenté aujourd'hui, et que j'ai le plaisir de coéditer avec ma collègue Géraldine Mastelli Weissrock, s'intitule « En-quête d'Orient. Destins croisés d'archéologues durant l'entre-deux-guerre » et paraîtra prochainement dans la collection Patrimoine photographique de l'École française d'Athènes. Il découle d'un projet dédié à l'orientalisme visuel à Strasbourg qui visait à réaliser un inventaire des photographies sur plaques de verre conservées dans les instituts d'art et d'archéologie du monde byzantin et de l'Orient ancien. Il s'agissait dans un premier temps de recenser dans une base de données toutes les informations relatives à chacune de ces plaques, c'est-à-dire non seulement le sujet de la photo, mais aussi les légendes inscrites sur les étiquettes ou encore les numéros d'inventaire visibles. Puis, dans un second temps, de numériser ces documents fragiles est souvent difficile à conserver. Sur ces étiquettes figure une quantité d'informations variable, souvent maigre, et parfois illisible. En général, l'on retrouve une indication du lieu de la prise de vue, parfois une description, plus rarement une date. Apparaissent également, et cela nous a aussi beaucoup intéressé, des étiquettes comportant la marque d'éditeurs photographiques et quelquefois des légendes qui se superposent, en français et en allemand, témoignant de l'histoire longue et complexe de l'université de Strasbourg. Ces plaques de verre couvrent un territoire immense, allant de l'Espagne à la Jordanie et de la Russie à l'Afrique du Nord, et elles ont servi de support de cours à des générations entières de professeurs. Nous étions toutefois incapables, au départ, de savoir si ces enseignants en étaient les auteurs, ni dans quel contexte ces images avaient été prises. Ce doute était renforcé par la présence, aux côtés de photos d'édifices ou de matériels archéologiques, dont on comprenait bien l'utilité pédagogique, d'images moins attendues, de personnages prenant la pose ou interagissant avec des habitants des lieux visités, qui s'apparentent davantage à des photos de voyage qu'à des documents destinés à être montrés aux étudiants. Parmi ces personnages, il y en avait un, ou plutôt une, qui a attisé ma curiosité. Il s'agissait d'une femme dont je ne parvenais pas à distinguer les traits du visage, sachant que les plaques font 8,5 cm par 10 cm. Mais je la reconnaissais grâce à son ombrelle ornée de bandes plus sombres sur le pourtour. Cette ombrelle, je la repère pour la première fois devant la petite métropole, au centre d'Athènes, sans y prêter vraiment attention. Mais je la retrouve ensuite à Alep, et quelques mois de travail plus tard, à Famagouste, à Chypre, aux côtés d'un homme. Ce jour-là, surprise ! Sur la plaque, je parviens pour la première fois à lire un prénom, Lucile, et un nom, Seyrig. A l'époque, je pense qu'il s'agit d'une certaine Lucile Seyrig, mais bien vite, je réalise que sur la photo apparaît l'archéologue Henri Seyrig, et que la femme à ses côtés est Lucile Gallé, épouse du professeur Paul Perdrizet, à qui l'on doit l'écriture de la légende. J'ai donc enfin des noms. Mais dans le même temps, ma collègue Géraldine découvre une date, celle de 1925, indiquée sur la légende d'une photo des célèbres lions d'Arslan Tash, enterrés dans le sable en Syrie du Nord. La découverte de ces plaques a été notre file d'Ariane. Nous venions de retrouver des clichés d'un voyage réalisé dans les années 1920 par Paul Perdrizet, voyage que nous avons pu retracer en réunissant trois fonds distants, Byzance, Orient ancien et Antiquité classique, dispersés en trois lieux différents et que rien ne pouvait a priori permettre de rapprocher. En 1924, l'Académie des Belles-Lettres confie à Paul Perdrizet une mission cruciale, explorer les territoires sous mandat français, la Syrie et le Liban, afin de déterminer quels sites seront fouillés par la France et lesquels seront cédés aux missions étrangères. Si cette responsabilité en est confiée à Perdrizet, c'est parce que le territoire lui est familier. En effet, durant les dernières années du XIXe siècle, ce membre de l'école française d'Athènes a réalisé des missions d'études épigraphiques en Syrie. Et il entretient par ailleurs des contacts étroits avec un des pères de l'archéologie orientale, le Belge Franz Cumont, qui recommande son nom à l'Académie. Perdrizet enseigne alors à l'université de Strasbourg, après avoir eu un poste d'enseignant à l'université de Nancy. Pour cette mission, il va travailler à la manière des membres de l'école, c'est-à-dire en s'associant à un jeune chercheur prometteur. Sans surprise, il ira le chercher à l'école, et son choix se portera sur Henri Seyrig, dont il entretient via sa femme de lointains liens familiaux. L'équipe part d'Athènes et fait escale à Rhodes et à Chypre. Pendant ce voyage, Perdrizet et Seyrig profitent de la compagnie de l'architecte et aquarelliste Albert Gabriel, qui travaille pour l'école française, notamment à Délos. A l'époque, Gabriel est actif en Syrie, sur le site de Palmyre, où il collabore avec la mission danoise. Ce voyage sera décisif pour lui car, dès leur retour, Perdrizet lui conseillera de candidater pour un poste à l'université de Strasbourg, qu'il occupera dès 1925. A partir de la fin des années 1920, il se consacrera pleinement à la Turquie et travaillera à la protection et à la restauration des monuments historiques, tout en contribuant à la formation des architectes et conservateurs. L'Université de Strasbourg a conservé des clichés extraordinaires par leur qualité qui donnent à voir tant des monuments emblématiques du paysage stambouliote que des scènes de la vie quotidienne. Quelques-unes de ces images figurent dans le catalogue en guise d'aperçu d'un volume qui leur sera bientôt entièrement dédié, mais une chose à la fois. Revenons à bord du Pierre Loti, le paquebot qui mène notre équipe de chercheurs à Beyrouth. Une fois débarqués, ils arpentent la Syrie, mais cette première mission est un peu décevante. Les sites que Perdrizet considérait comme prometteurs ne livrent que peu de matériel. Il se concentre donc sur le port d'Antioche, Séleucie de Piérie, et explore plusieurs sites dans les environs. Henri Seyrig, de son côté, va être confronté avec un type d'art qui lui était complètement méconnu et qui suscite en lui une véritable fascination. Il se passionne notamment pour la sculpture des sanctuaires arméniens situés aux alentours du Mont Admirable. Il y observe d'ailleurs des rituels étonnants, tels que des sacrifices de moutons pour la fête de l'invention de la Sainte Croix. Ce rite, nous le retrouvons en photo, et c'est grâce à la légende conservée écrite par la main de Perdrizet que l'on peut la relier à cet événement décrit par Seyrig dans sa correspondance. Un nouveau rebondissement dans notre enquête survient lorsque nous découvrons, sur certaines plaques de verre, le monogramme DS. En restituant ces plaques dans le cadre de la mission Perdrizet, nous comprenons qu'elles se rapportent au second voyage, réalisé en 1925. En effet, cette année-là, l'équipe se voit enrichie d'un compagnon supplémentaire. Il s'appelle Daniel Schlumberger, DS donc, il est le neveu de Perdrizet et est à l'époque étudiant à l'université de Strasbourg. Ce tout jeune homme d'à peine 20 ans se liera d'une forte amitié avec Seyrig qui deviendra son mentor et avec qui il collaborera jusqu'à la fin de sa vie. Dès lors, le cadre était fixé et nous venions de faire connaissance avec les quatre protagonistes de la quête de l'Orient, Perdrizet, Seyrig, Schlumberger et Gabriel. Mais nous n'étions pas au bout de nos surprises ! Toujours à la recherche de documents relatifs aux premières missions en Syrie et au Liban, nous retrouvons un jour par un pur hasard dans le musée Adolf Michaelis de l'université de Strasbourg une enveloppe jaunie, elle nous intrigue car elle comporte une date griffonnée qui nous est bien connue celle de 1925 et le nom de Schlumberger. De fait, elle contient bel et bien des photos du voyage mais ce sont cette fois des tirages et non plus des plaques de verre. Schlumberger a 30 ans de moins que Perdrizet, il est à la pointe de la technologie. Motivé par cette découverte, nous reprenons nos fouilles dans les différents instituts. Quelques mois plus tard, en ouvrant une armoire, nous tombons sur une caisse de prime abord peu attrayante, laconiquement annotée « documents administratifs » , qui se délitent complètement sous nos doigts quand on l'ouvre. À l'intérieur, le Graal. Un ensemble conséquent de photos, de lettres, de cartes, d'enveloppes et d'albums côtoient notes de cours et épreuves d'examens. L'ensemble, ainsi reconstitué, relate les parcours de ces archéologues entre 1924 et le début de la seconde Guerre mondiale. Quinze années d'exploration de cet espace largement méconnu que les archéologues désigneront par le terme générique d'Orient. Au fil des images, on se plonge dans l'intense activité archéologique de l'entre-deux-guerres ou le service des antiquités, dirigé par Seyrig, secondé par Schlumberger, collabore avec les musées locaux et avec les missions étrangères pour mener des fouilles mais aussi des prospections, des inventaires et des campagnes de restauration. On découvre en même temps que les archéologues des monuments méconnus couvrant une chronologie large de la tombe romaine d’Al-Dana en Syrie du Nord, devant laquelle pose une minuscule fillette, jusqu'au Krak des chevaliers, en passant par la basilique byzantine de Saint-Serge à Rezafa. Mais les forces des archéologues se concentrent sur un site majeur, Palmyre. Ce site, on le découvre d'abord à travers les yeux de Gabriel, qui y est rappelons-le présent en 1925 : « Le soir dans l'heure qui précède le coucher du soleil, le panorama revêt un caractère singulièrement expressif [...] Les colonnes innombrables restées debout [...] s'enlèvent en l'accent lumineux [...] dans l'atmosphère limpide du désert [...] Ainsi s'étale sous les yeux un véritable plan en relief. » Lorsque les fouilles débutent en 1929, les restaurations préconisées par Gabriel sont à l'ordre du jour. C'est l'architecte Robert Amy qui s'y attellera en s'attaquant à la restauration de l'arc monumental. Mais pour fouiller et restaurer le temple de Bêl, il faut évacuer le village qui s'y est installé et qui porte le nom de Tadmor. La vie quotidienne et le démantèlement de ce village, construit essentiellement en matériaux de remploi, sont documentés pas à pas par les photographies. Palmyre, c'est The Place to Be dans les années 1930. Sa découverte fait rêver, les ruines qui se dressent dans le désert en font un lieu de prédilection pour les écrivains, les artistes, les aventuriers de toute origine. Tout ce monde loge dans l'hôtel Zénobie tenu par l'énigmatique Marga d’Andurain, trafiquante de perles et d'opium, empoisonneuse sans scrupules, le mythe qui se tisse autour d'elle est épais en tout cas celle qui a été la première femme occidentale à se rendre à la Mecque entretient des rapports privilégiés avec les archéologues et joue un rôle considérable pour apaiser les tensions qui peuvent survenir entre ces derniers et la population locale. Nous la retrouvons sur une des photos de la fouille de Palmyre, tendant sa veste, derrière une sculpture en train d'être photographiée. Ce n'est pas la seule femme à croiser la route de nos équipes d'archéologues. Hermine de Saussure, l'épouse d'Henri Seyrig et mère de l'actrice Delphine Seyrig, navigatrice et exploratrice, est présente aux côtés de son mari. Ses amis, voyageuse et journaliste et Anne-Marie Schwarzenback viennent aussi découvrir la perle du désert comme on appelle Palmyre à l'époque . Agatha Christie visite aussi la fouille en compagnie de son époux Max Mallowen. Ils logeront au Zénobie, que la romancière décrira comme propre mais sentant le soufre . Tous ces hôtes de marque contribuent à faire du site un lieu de rencontre et d'échanges culturels. Les photographies conservées nous font entrer dans le quotidien des archéologues , dans les campements qu'ils montent, les repas qu'ils partagent, les paysages qu'ils observent et parfois la vie s'invite de façon inattendue. Les plus observateurs découvriront un petit chat, qui s'est glissé dans une photo de groupe, témoin discret de l'aventure archéologique. Μais nous partageons surtout, les moments de découverte qui les passionnent. Οn suit ainsi Schlumberger dans sa découverte de la Palmyrène. Au coeur de cette région, pourtant considérée comme déserte en raison de son aridité , il découvrira une vingtaine de chapelles, de forts et de temples, dont celui d'Abgal, identifié comme le centre religieux de la Palmyrène. Schlumberger est un fervent défenseur de la photographie aérienne, qu'il considère comme un outil essentiel de prospection archéologique. Pour ses fouilles en Palmyrène et le suivi des travaux à Palmyre, il s'appuie à la fois sur les explorations pionnières du Père Poidebard, de l'université Saint-Joseph de Beyrouth, et sur les reconnaissances aériennes, qu'il mène lui-même avec le 39e Régiment d'Aviation. Parallèlement à ces missions, nos archéologues voyagent à la rencontre d'équipes étrangères actives sur différents sites. Nous les suivons par exemple lors d'une rencontre organisée avec leurs homologues travaillant en Jordanie, sous mandat britannique, George Horsfield et Agnes Conway, un voyage réalisé à l'hiver 1931, durant lequel ils découvrent les sites de Petra et de Jérash. Seyrig apparaît aussi dans les clichés d'une visite à Apamée-sur-l’Oronte, au nord-ouest de la Syrie, dont la concession a été obtenue par la Belgique grâce à son appui. Encore une fois, le personnage pivot est Franz Cumont, dont la correspondance avec Seyrig, conservé à l'Academia Belgica de Rome, nous apprend que celui-ci a facilité les démarches et organisé plusieurs visites lors des campagnes dirigées par Fernand Mayence et Henri Lacoste. Les rencontres ainsi réalisées, induisent une grande mobilité entre équipes, avec par exemple des architectes actifs simultanément sur plusieurs sites. De ces échanges constants, découle la création d'un réseau qui se manifeste par des envois et des réceptions de lettres dans lesquelles des opinions sont échangées sur la datation ou l'identification de tel ou tel vestige ou objet. La Seconde Guerre mondiale va mettre ses missions à l'arrêt et il en va de même du côté athénien. Plusieurs membres seront enrôlés dans l'armée du Levant. Dans l'album des membres conservé à l'école française d'Athènes, on en retrouve quatre. Roland Martin, Henri Metzger, Ernest Will et Pierre Amandry découvrent la Syrie aux côtés d'Henri Seyrig, qui les accueille à Palmyre et qui leur fait visiter le site de Baalbeck. A l'issue du conflit, en 1946, Henri Seyrig fonde l'Institut français d'archéologie de Beyrouth, futur institut français du Proche-Orient. Son ami et ancien collègue Daniel Schlumberger prend quant à lui, en 1945, la tête de la Délégation archéologique française en Afghanistan. A partir de 1955, Schlumberger devient professeur à l'université de Strasbourg, où il dispense les cours d'art byzantin, d'archéologie classique et d'archéologie du Proche-Orient. Quelques années plus tard, en 1967, il succède à Seyrig, à la tête de l'IFPO. Albert Gabriel a quant à lui largement contribué à la création de l'Institut français de Stamboul, futur Institut français d'études anatoliennes, qu'il dirigera à partir de 1930. Ce sont donc ces années, fastes pour l'archéologie orientale, que ce catalogue propose de faire découvrir, grâce à une sélection de 152 documents photographiques et textuels. Ils sont précédés de contributions introductives, replaçant ces photos dans leur contexte général, et rédigées par des chercheurs issus de l'ensemble des institutions partenaires du projet. C'est là pour nous le principal atout de ce travail, c'est-à-dire qu'il a servi en quelque sorte de prétexte, pour que plusieurs institutions entament des prospections dans leur propre fond et que soit ainsi créé un dialogue entre ces documents. Mais surtout, ce catalogue, qui constitue une invitation au voyage, accompagnera une exposition qui va elle-même voyager en plusieurs lieux. Elle sera présentée pour la première fois à Strasbourg en septembre prochain, puis à Rhodes à la fin du mois d'octobre. Ensuite, elle aura la chance d'être accueillie par le musée byzantin et chrétien d'Athènes au printemps 2026, avant de continuer , nous l'espérons, vers Istanbul et Beyrouth. En présentant côte à côte photographies et objets matériels, elle permettra de se plonger au plus près du quotidien des archéologues dont on suit l'évolution, des premières découvertes de ces lieux méconnus jusqu'à l'achèvement de grands travaux sur des sites majeurs. Cet ensemble de documents, présentés dans l'exposition et dans le catalogue, feront découvrir d'une manière inédite l'ensemble de la chaîne opératoire des travaux scientifiques, de la prospection à la fouille et de la documentation à la publication, à travers l'évolution de la pratique de la photographie sur le terrain. Il témoigne aussi d'un changement du regard que les archéologues posent sur ces régions qu'ils parcourent. De la composition d'images orientalisantes, où des enfants en costume traditionnel posent de côté de monuments ensablés, nous passons à des photographies prises sur le vif, qui, bien que teintées d'une tendance ethnographique, mettent surtout en avant les collaborateurs et les interlocuteurs des chercheurs sur le terrain. Les images que nous vous invitons à découvrir dépeignent donc des histoires personnelles qui se mêlent à l'histoire de la discipline, et qui manifestent la capacité des chercheurs à saisir les opportunités politiques et sociales et à façonner ainsi le paysage scientifique et institutionnel. Et qui sait, peut-être découvrirez-vous, vous aussi, au détour d'une colonnade, les contours familiers ombrelle à rayures ?