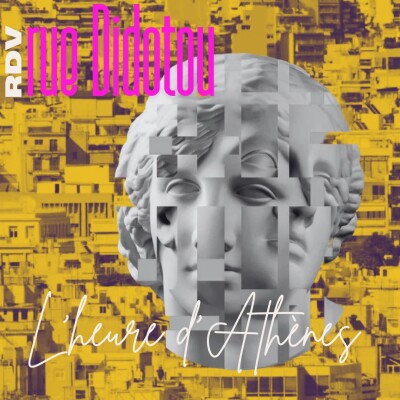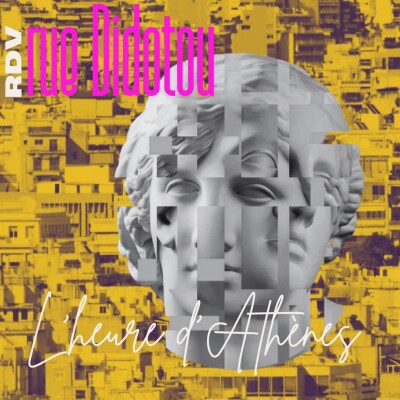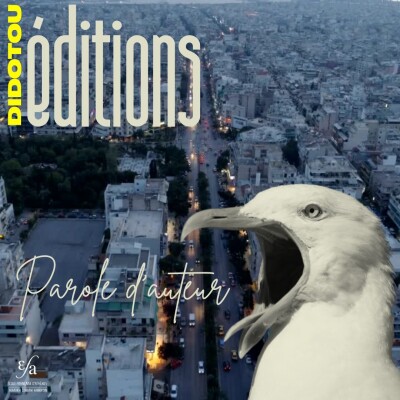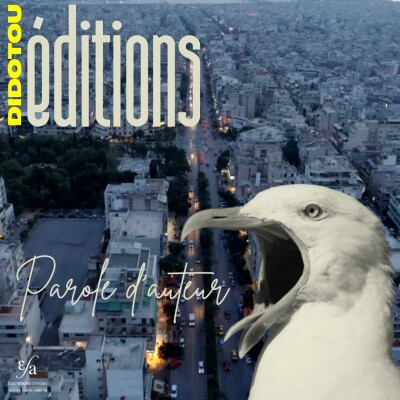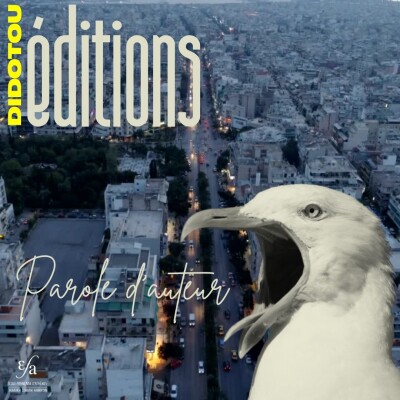Speaker #0Je voudrais remercier ce soir très chaleureusement Véronique Chankowski de son invitation à présenter devant vous des recherches, qui en effet ne se font pas dans le cœur du monde grec, mais sur un territoire situé dans l'une de ses marges, l'Égypte, dont la civilisation millénaire a marqué les esprits dès l'Antiquité. Ces travaux se font dans le cadre de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, l'une des cinq écoles françaises à l'étranger, au même titre que l'école française d'Athènes, et ce sera ici l'occasion de souligner les problématiques communes et les projets de recherche en cours qui unissent nos deux instituts. En introduction tout d'abord, il me semble important de faire un rappel chronologique sur l'arrivée des Grecs en Égypte et les modalités de leur implantation à l'époque hellénistique après la conquête d'Alexandre. Ce territoire est souvent mal connu et exclut des recherches sur le monde grec, bien souvent parce que l'on pense que la situation des Grecs en Égypte diffère totalement de celle qu'ils ont rencontrée ailleurs, au point que les comparaisons sont inutiles. J'espère vous montrer ce soir qu'il existe en effet une originalité de la présence grecque en Égypte, mais aussi des points de ressemblance nombreux. L'Égypte hellénistique n'a pas été une exception, mais plutôt le résultat de l'une des solutions mises en place par un pouvoir macédonien pour prendre en main et exploiter un territoire nouvellement conquis. Qui ont été ces Grecs ? Où ont-ils été implantés ? Dans quelles conditions ? C'est ce que j'essaierai de vous présenter ce soir, tout en soulignant que la présence grecque en Égypte a été bien plus multiforme qu'elle n'a été présentée jusqu'ici, en fonction des contextes rencontrés par les nouveaux venus. Je me concentrerai plutôt sur les premiers moments de l'arrivée de ces personnes en Égypte, sur lesquels les avancées sont les plus évidentes et celles qui renouvellent le mieux nos données. Je précise enfin que je parlerai ce soir indifféremment de grec ou d'Hellènes, au sens large en tout cas, ce qui inclus dans l'Égypte hellénistique une population beaucoup plus vaste. que les simples Grecs. Évidemment, cette communauté intègre également les Thraces et autres peuples hellénisés du nord du monde grec, les Juifs et aussi toutes les autres populations qui ont participé à la colonisation de l'Égypte. Les Grecs n'ont pas découvert l'Égypte avec Alexandre. Les relations entre les mondes grecs et égyptiens sont plus anciennes et remontent au IIe millénaire avant notre ère. Elles se sont surtout développées à partir de l'époque archaïque sous l'impulsion des pharaons de la 26e dynastie qui ont œuvré à l'ouverture de leur pays vers la Méditerranée. Cela se matérialise par l'octroi de la part du pharaon Amasis d'un accès privilégié à l'Égypte pour les commerçants du monde grec et par la possibilité pour les Grecs de s'installer durablement sur le site de Naucratis au cœur du delta égyptien. Vous voyez ici un plan de ce village égyptien préalablement occupé, et qui accueille, à partir du VIIe siècle avant J.-C., une communauté hellène importante qui a laissé des témoignages nombreux de son implantation et dont vous avez ici un aperçu très rapide. Mais c'est bien sûr avec la conquête d'Alexandre, l'installation d'une dynastie gréco-macédonienne à la tête de l'Égypte, les Lagides, et surtout l'établissement de dizaines de milliers de nouveaux arrivants sur le sol égyptien, que les relations entre culture grecque et culture égyptienne vont s'intensifier comme jamais. C'est au début de son entreprise de conquête qu'Alexandre fait un détour en Égypte avant de se lancer à l'assaut du cœur de l'Empire perse. Il s'agit pour lui d'assurer ses arrières. Alexandre passe seulement quelques mois dans le pays, entre l'automne 332 et le début de l'année 331, mais il a le temps d'accomplir des gestes importants, notamment en sacrifiant au dieu taureau Apis à Memphis. et en consultant l'oracle d'Ammon à Siwa. Il fonde également Alexandrie, au bord de la mer Méditerranée, ce qui représente une modification fondamentale pour un territoire habituellement gouverné depuis l'intérieur des terres. À son départ, il laisse derrière lui des hommes à la tête de l'Égypte et s'appuie pour contrôler le pays sur des Macédoniens, notamment pour commander les troupes, vous voyez leur nom à l'écran, mais aussi sur des administrateurs perses et égyptiens. et sur un personnage fondamental, Cléomène de Naucratis, un grec d'Égypte. Celui-ci, fort de sa connaissance intime de l'Égypte, a le profil parfait d'un passeur. La présence d'Alexandre en Égypte a laissé évidemment très peu de traces. Et c'est à Ptolémée, fils de Lagos, qui hérite de l'Égypte à sa mort en 323, que l'on doit la mise en place du système de gouvernement qui va ensuite organiser l'Égypte durant trois siècles. Ptolémée agit tout d'abord en tant que satrape, puis il se proclame Basileus, roi d'Égypte, vers 305-304 avant notre ère, après s'être débarrassé de plusieurs de ses adversaires à l'extérieur, comme à l'intérieur, dont le fameux Cléomène de Naucratis. Alors que les historiens insistent souvent sur le rôle fondamental et réel de son fils Ptolémée II dans la construction des fondations de l'Égypte hellénistique, qui vont permettre au royaume de demeurer indépendant jusqu'à la mort de Cléopâtre VII en 30 avant Jésus-Christ, Il ne faut pas négliger non plus le rôle du premier des Lagides. On lui doit parmi d'autres la mise en place de ce que l'on appelle l'idéologie royale Lagide, avec un souverain à deux faces, macédonien et égyptien, la création de la figure divine et syncrétique de Sarapis, ou encore la fondation du musée d'Alexandrie. On sait aussi et surtout qu'il a étendu le territoire de son royaume au-delà de l'Égypte pour donner naissance à un véritable empire, qui comprendra sous le règne de son fils la Cyrénaïque, Chypre et la Syrie-Phénicie. À l'intérieur de l'Égypte, il se place dans les pas des pharaons égyptiens et reprend pour bonne part les structures administratives du pays, sans doute conseillées en cela par des élites égyptiennes qui se mettent rapidement à son service et qu'il sollicite dans tous les domaines, armée, économie, mais aussi évidemment dans le domaine de la culture et de la religion. Ptolémée Ier a eu également un impact durable sur les modalités et la géographie de l'implantation des Hellènes en Égypte même. Ceux-ci sont arrivés par milliers dans les premières décennies de son règne et continueront de venir s'installer en Égypte au cours du IIIe siècle essentiellement. Dans les textes à notre disposition, nous voyons qu'ils viennent de l'ensemble du monde hellénistique avec une forte proportion de Macédoniens, de Cyrénéens et de Thraces. Mais l'on trouve aussi des personnes venues d'Asie mineure, du Péloponnèse, des îles grecques, d'Occident et du Levant. Un bon nombre d'entre eux s'installent évidemment à Alexandrie, devenue la capitale officielle du royaume vers 311 après la décision de Ptolémée Ier d'y transférer sa cour. Il était installé jusque-là à Memphis. D'autres s'implantent aussi à Ptolémaïs, fondée par Ptolémée Ier en Haute-Égypte pour contrôler le sud du pays. Mais avec Naucratis, Alexandrie et Ptolémais, ce seront les seules cités grecques d'Égypte durant toute l'époque hellénistique. Cela implique que de nombreux Grecs installés en Égypte, si ce n'est la majorité, ne vivront pas dans un contexte civique, ce qui contraste assez grandement avec le reste du monde grec. C'est à n'en pas douter un choix délibéré de la part de Ptolémée Ier et de ses successeurs. À la place, et pour implanter le flot de nouveaux arrivants, qui ne peuvent pas tous s'installer dans les trois cités d'Égypte, Ptolémée Ier opte pour un système original, celui de la clérouquie, qui sera repris et amplifié par ses successeurs. Dérivé du mot grec kleros, qui signifie parcelle ce système prévoit la distribution de lots de terre agricoles à des soldats en échange de leurs services militaires, avec des superficies proportionnelles à leur rang au sein de l'armée. Le système présente des avantages pour le pouvoir lagide. Il permet tout d'abord de disposer d'une armée mobilisable. rapidement sans avoir à supporter les coûts d'une solde régulière. Il permet deuxièmement d'installer à moindre coût les flots de nouveaux arrivants hellènes et d'assurer leur loyauté. Troisièmement, le système permet aux souverains lagides d'asseoir leur pouvoir sur le territoire mais aussi de l'exploiter au mieux pour en tirer des revenus dont il a besoin pour construire la nouvelle capitale et pour mener la politique offensive qu'il conduit à la tête de son armée en méditerranée. Enfin, En installant des colons hellènes sur des terres égyptiennes, les Ptolémées facilitent l'intégration culturelle de leur population, même si, évidemment, le système engendre des frictions avec les Égyptiens préalablement établis dans ces régions, qui illustrent des défis de la gestion d'un royaume multiculturel. En effet, à l'arrivée des Grecs en Égypte, le pays est déjà largement peuplé et urbanisé, avec une densité d'habitants qui est sans doute parmi les plus hautes du monde antique. Or l'Égypte est dotée d'un territoire utile restreint, soumis à des crues annuelles, dont vous avez ici une représentation antique, la mosaïque de Palestrina, et puis des photographies d'archives qui montrent les effets de la crue avant la construction du grand barrage d'Assouan. Pour ne pas déséquilibrer ce statuquo et un système qui fonctionne et qui rapporte énormément au trésor lagide, les clérouques sont installées en priorité dans des régions de moindre densité, préalablement moins urbanisées. Cela permet d'une part de bien les doter, mais aussi de développer ces régions et d'en faire des fronts pionniers. L'oasis du Fayoum est le plus célèbre de ces fronts pionniers. Elle connaît un développement remarquable, notamment sous Ptolémée II, qui y encourage l'installation des clérouques. Il attribue également des grands domaines ou des doreai à certains grands de la cour. C'est alors une période de développement intense avec le développement, la fondation, de dizaines de bourgades. On connaît environ le nom de 150 localités dans la région. Les nouveaux arrivants introduisent de nouvelles techniques agricoles et améliorent la productivité et diversifient les cultures. Cela est très bien connu grâce aux archives de Zénon, l'intendant de l'un de ces grands domaines, celui d'Apollonios. qui était le ministre des Finances de Ptolémée II. Les archives de Zénon permettent de brosser un portrait très vivant de la vie quotidienne de la petite société qui s'est développée dans le Fayoum au milieu du IIIe siècle. Elle montre en particulier comment, durant une dizaine d'années, cet homme originaire de Caunos, en Carie, va œuvrer à exploiter un domaine immense, 10 000 aroures, c'est-à-dire plus de 2700 hectares, à la tête d'un réseau d'agents et de collaborateurs grecs et égyptiens. Les travaux réalisés pour mettre en valeur cette exploitation sont de grande ampleur et font intervenir des centaines d'ouvriers. Et vous voyez ici à l'écran un croquis des canaux à creuser dans la dôréa qui nous est parvenu, dressé par un certain Stothoetis et accompagné par un texte qui décrit ces travaux. L'intervention d'Apollonios, le ministre des Finances de Ptolémée II, transparaît aussi dans des lettres qu'il envoie à Zénon pour favoriser la diversification des cultures et adapter au sol égyptien de nouvelles variétés. Vous voyez qu'il fait venir des jeunes poiriers greffés, des plants de pommiers, des pins, du vignoble, des oliverais, etc. Zénon, quant à lui, recopie de sa main un manuel de viticulture. Les Grecs vont donc jouer un rôle notable dans le développement de la région. Toutefois, il serait faux de croire que le Fayoum a été une sorte de Far West, vide, où les Grecs se seraient installés ex nihilo ou presque. Les travaux de Willy Clarysse et Dorothy Thomson, fondés sur l'examen de listes de recensement qui nous sont parvenus, ont permis de faire de grandes avancées et de nuancer cette image qui avait déjà été mise en cause par les historiens de l'Égypte pharaonique, qui eux avaient démontré que le Fayoum avait connu une première mise en culture au Moyen-Empire. Clarysse et Thomson ont montré quant à eux que le nombre de vraies fondations de villages était très faible et que les colons gréco-macédoniens étaient très minoritaires. Alors ce tableau qui est... un peu peut-être sec et difficile à comprendre, est très utile car il permet de comprendre que sur une population connue qui peut être estimée entre 85 et 95 000 habitants dans le Fayoum au IIIe siècle avant Jésus-Christ, la population grecque se monte à seulement 30%, 15% sont des soldats en activité et 15% sont des Hellènes sur le plan fiscal, c'est-à-dire des civils. Ainsi, les travaux de mise en œuvre de la région se sont-ils nécessairement appuyés sur une expertise égyptienne, comme le montre d'ailleurs le devis établi par Stothoetis que je vous ai montré juste avant. Willy Clarysse a mis également en évidence l'existence de déplacements de populations égyptiennes de la vallée vers le Fayoum, au début de l'époque hellénistique, qui a donc aussi été peuplée d'Égyptiens venus des régions voisines, pour mettre en valeur les terres du Fayoum. La cohabitation entre Hellènes et Égyptiens a été immédiate dans la région. Cela s'est matérialisé par l'adoption rapide par les Grecs du Fayoum de divinités égyptiennes au sein de leur panthéon personnel. Les lieux de culte en l'honneur des dieux crocodiles Sobek ou Souchos fleurissent un peu partout, y compris et aux côtés d'autres édifices plus classiques, tels que des gymnases, temples de Zeus ou même un théâtre. Un peu plus tard, on voit apparaître la mention de mariages mixtes à partir de la fin du IIIe siècle et la naissance de pratiques funéraires originales mêlant usage grec et égyptien. Ces phénomènes de transfert culturel ont été nombreux et montrent que les Hellènes du Fayoum n'ont pas vécu en vase clos et que les différentes franges de la population de la région se sont rencontrées par nécessité ou par choix. En dehors du Fayoum, des clérouques sont attestés par les textes dans plusieurs régions, je ne vais pas entrer dans les détails, mais qui sont extrêmement limitées. Ailleurs, ils sont... quasi inexistants de notre documentation. Par exemple, à Edfou, dans le sud de l'Égypte, au IIe siècle avant notre ère, un recensement permet de dénombrer 120 d'entre eux seulement, sur environ 70 000 habitants. Et encore, ces clérouques sont-ils sans doute d'origine égyptienne ? De là est née l'image d'une population grecque établie en Égypte durant le premier siècle du règne des Lagides, seulement dans quelques pôles. Les cités grecques, certaines métropoles égyptiennes et surtout le Fayoum, laboratoire des Lagides et région privilégiée pour l'installation des nouveaux arrivants. Cela vient du fait que cette histoire a été écrite à partir d'une documentation déséquilibrée. Déséquilibrée tout d'abord sur le plan de sa provenance. Elle provient quasiment uniquement du Fayoum, mais plus spécifiquement des archives de Zénon, qui comportent à elles seules 2000 documents, ce qui représente un tiers de tous les papyrus en langue grecque trouvés en Égypte toute époque confondue. Il s'agit là d'un véritable biais de notre documentation. Mais il faut dire qu'aucun papyrus n'a été trouvé à Alexandrie, Naucratis ou dans le Delta, en raison du climat humide de la partie nord du pays. Par ailleurs, la documentation écrite en langue égyptienne tardive, le démotique, a été ignorée par les premiers historiens de l'Égypte hellénistique, ce qui a assurément orienté le point de vue et focalisé l'attention sur la population d'origine ou de culture grecque. Surtout, les sources archéologiques ont été longtemps négligées, en particulier, paradoxalement, en raison de l'abondance de papyrus, qui a pu faire croire que l'on pourrait s'en passer, même dans le fayoum. En effet, les vestiges archéologiques qui auraient pu compléter ou au contraire relativiser les textes que j'ai évoqués plus haut ont été négligés par des chercheurs, avant tout attirés par les papyrus. Or, ces papyrus se trouvent majoritairement dans les cartonnages de momies, ils étaient remployés pour faire des cartonnages, ou dans les dépotoirs. Comme l'ont très rapidement compris les papyrologues, vous avez ici à droite un récit très vivant de la technique de fouille des grands Grand Valley Hunt qui suivent les couches pleines de papyrus comme des filons dans une mine d'or. En revanche, les villages situés à proximité de ces nécropoles ou de ces dépotoirs vont quant à eux être très rarement explorés, alors même que leur état de conservation est particulièrement remarquable. Or depuis, ils ont beaucoup souffert de destruction et de pillage. Vous voyez ici à l'écran l'exemple du village de Philadelphie, qui était la ville de résidence de Zénon. On voit l'état de conservation sur cette photographie aérienne prise en 1925 par la Royal Air Force, ou encore sur ce cliché d'un des temples de Philadelphie en 1907 et 1908. L'état actuel du site en 2015 est assez peu engageant, mais un collègue de l'IFAO, Huaiying Chang, a engagé des fouilles qui ont permis de se rendre compte qu'une partie des vestiges était malgré tout conservée, mais très arasée. Un second exemple vient de Théadelphie, qui est un petit village du centre de l'Oasis. et où vous voyez l'état de conservation absolument remarquable de l'un des temples du village, le temple dédié au dieu Pnéphéros, exploré par Breccia en 1912-13. Vous voyez que les murs sont entièrement préservés et que l'inscription, la dédicace du temple est encore en place. Et une photo prise en 2011 du même site, où il ne reste plus que le vestige d'un grand château d'eau. Le temple a entièrement disparu et on ne peut plus le localiser et son emplacement a désormais été perdu. Heureusement, ces biais de la documentation sont en voie de résorption. Grâce à de nouvelles approches empruntées par les historiens, davantage interdisciplinaires, et à la multiplication des fouilles, y compris dans le Fayoum, mais aussi et surtout dans certaines régions jusqu'ici délaissées. À Alexandrie, les fouilles se sont accélérées à l'initiative du CEAlex, fondée par Jean-Yves Empereur et désormais dirigée par Thomas Faucher, qui permettent de disposer de données beaucoup plus nombreuses sur l'occupation de la ville durant les premiers siècles de son histoire. Je ne m'arrêterai pas sur les travaux effectués dans cette ville, car il faudrait une conférence tout entière pour évoquer les résultats. Je voudrais en revanche présenter trois cas d'études rapides et récents, qui me semblent apporter des nuances ou des compléments au tableau dressé précédemment sur l'arrivée des Grecs en Égypte et sur leur installation durant le premier siècle du règne des Lagides. Je voudrais montrer tout d'abord comment il est possible, en l'absence de texte, de mesurer l'ampleur de la diffusion des Grecs et de la culture grecque dans le territoire grâce à l'archéologie, en identifiant et en suivant ce que j'ai appelé des marqueurs de présence grecques. L'un des marqueurs les plus fiables est constitué par les bains collectifs que j'ai étudiés en détail il y a quelques années de cela avec mon collègue Thibaud Fournet. Comme ils se conservent bien, grâce à l'usage de la pierre, de la brique cuite et du mortier, ils ont résisté à l'humidité du Delta, contrairement au papyrus. Il forme donc un corpus représentatif à l'échelle de l'Égypte. Or, les bains collectifs sont une importation des Grecs d'Égypte. Les Égyptiens ont bien sûr développé des pratiques d'hygiène et des douches sont attestées dans des habitats luxueux d'époque pharaonique. Les Grecs ont quant à eux développé un type de bain particulier qui se déroule dans des édifices collectifs et ouverts au public, moyennant un prix d'entrée très faible. A l'intérieur, on se lavait par aspersion dans des cuves plates, comme vous le voyez ici sur la restitution de Thibaud Fournet, avant de s'immerger dans des baignoires ou des piscines collectives pour se relaxer, comme sur la photo au milieu en haut. Ces bains sont très reconnaissables avec leurs deux tholoi ou rotondes qui accueillent les cuves plates. Certaines pouvaient accueillir une clientèle nombreuse, jusqu'à 50 personnes à la fois. L'architecture de ces bains fait de facto de ces édifices des espaces sociaux où l'on rencontrait nécessairement l'autre. Nous avons pu recenser 35 de ce type de bains en Égypte, ce qui représente la moitié des édifices de type grec connus à ce jour dans toute la Méditerranée, où l'on en compte 71. En plus des 35 bains avec Tolos, un autre édifice, type d'édifice plus petit, qui pouvait accueillir une demi-douzaine d'individus, a également émergé spécifiquement en Égypte, comme vous le voyez ici à l'écran. Et l'on compte une quinzaine de ces petits bains sur tout le territoire égyptien. C'est dire le succès gigantesque du bain collectif grec en Égypte. Or ces bains sont présents partout. Évidemment ! ils sont nombreux dans les régions où l'on sait qu'il y avait des Grecs, notamment le Fayoum. Mais leur diffusion précoce dans des zones où il y a peu de Grecs, par exemple ici sur le parvis du temple d'Amon à Karnak, la ville actuelle de Luxor, me semble être le marqueur de la diffusion des Grecs au cœur du pays, notamment au sein de l'armée ou de l'administration. Certes, dans ces espaces moins hellénisés, les Grecs étaient encore plus minoritaires que dans le Fayoum. Mais cette carte à gauche montre, selon moi, qu'il ne faut pas négliger un aspect essentiel de la présence grecque en Égypte. Elle a été diffuse et spatialement généralisée, même si en intensité, elle a beaucoup varié selon les régions. Cette carte des Bains démontre aussi très nettement une présence importante des Grecs dans le Delta occidental. Les textes à notre disposition semblaient en effet suggérer que la région avait été largement colonisée par des Hellènes au début de l'époque hellénistique, pour des raisons évidentes de proximité avec Alexandrie. Il me semble que cette carte ici le démontre. Des travaux de terrain récents ont permis de le confirmer, ce qui fera l'objet de mon second point. Ce second point vise à remettre en cause l'exceptionnalité de la situation du Fayoum. Je voudrais montrer comment la région de la Maréotide, qui s'étend autour du lac Maréotis, qui est au sud d'Alexandrie, comment cette région a été un autre front pionnier des Lagides. Avant la fondation d'Alexandrie, Et contrairement à ce que l'on pensait jusqu'à très récemment, la région n'est pas un no man's land. Elle a au contraire été intégrée au territoire égyptien par le pouvoir pharaonique qui a implanté des garnisons et y a créé de grands domaines agricoles. C'est le cas notamment sur le site de Plinthine, dont les vestiges sont étudiés depuis 2002 par la mission française de Taposiris et Plintines, fondée par Marie-Françoise Boussac, et que j'ai désormais le plaisir de diriger. Voici une vue du site de Plinthine. Nous avons démontré que le site était occupé depuis au moins la 18e dynastie, c'est-à-dire le XIVe siècle avant Jésus-Christ. Un temple y est construit sous Ramsès II, et l'on sait qu'une garnison probablement s'y établit à la même époque. En parallèle, une activité de production de vin s'y développe, comme le démontre la découverte d'une anse de jarre vinaire au nom de Merytaton, fille d'Akhenaton. Cette production de vin trouve son apogée Au VIIe siècle, VIe siècle avant J.-C., comment témoigne la quantité phénoménale de pépins de raisin découverts dans tous les contextes dégagés, ainsi que le fouloir remarquablement préservé que nous avons mis au jour dans un quartier daté de cette période. C'est probablement en raison de cette activité viticole que le site de Plinthine est connu des Grecs avant la conquête d'Alexandre. Hellanikos, un auteur un peu obscur du Ve siècle avant J.-C., dit ainsi que la vigne a été inventée à Plinthine, ce qui témoigne du fait que les Grecs étaient conscients de la haute antiquité de la viticulture sur le site. Hérodote, quant à lui, évoque le golfe de Plinthine, ce qui est également significatif. À n'en pas douter, le monticule formé par les constructions en briques crues de Plinthine, ce qui en grec signifie qui est fait d'argile ou de briques crues donc ce monticule formait un point de repère très utile pour les nombreux marins grecs qui ont abordé les côtes égyptiennes à cette époque. Après une époque, une période sur laquelle nous n'avons pas beaucoup d'informations, au IVe et Ve siècle avant J.-C., le site de Plinthine est réoccupé, à peine quelques décennies après la fondation d'Alexandrie, à quelques 40 km de là, par une petite communauté de colons grecs dont la nécropole a été étudiée par mes collègues. Il s'agit d'une réplique miniature, très petite, très modeste, de la nécropolis d'Alexandrie qui mêle des tombes de surface et des hypogées collectifs et dans lesquelles les incinérations et les inhumations sont attestées côte à côte. Outre des pratiques funéraires de type grec, les décors et le mobilier funéraire s'inscrivent dans la tradition grecque. Le village a été implanté à 500 mètres de là, sur les pentes sud du site. Pour le moment, un seul édifice a fait l'objet de fouilles. Il s'organise en deux parties, dédiées pour part à la transformation agricole et pour l'autre à l'habitat. Ici, vous avez une vue de la partie dédiée à l'habitat. La qualité de la construction de cette partie apparaît tout particulièrement dans le soin apporté à la salle de bain, dotée d'une cuve plate qui est installée sous la cage d'escalier menant à l'étage. L'une des raisons de l'installation d'une colonie grecque à Plinthine tient sans doute en l'existence d'un terroir propice à la viticulture, nous l'avons vu. Les nouveaux arrivants n'ont pas attendu longtemps pour reprendre cette activité, ce qui se manifeste notamment par la construction d'un chais, c'est-à-dire d'un édifice de production de vin, au milieu des vignes, au cours du IIIe siècle avant J.-C. Ce chais est doté d'un fouloir et d'un pressoir à treuil, donc d'un fouloir, et d'un pressoir à treuil fixé sur contrepoids. d'un modèle très commun en Méditerranée. Après avoir été pressé ou foulé, la cuvée était ensuite transvasée dans des amphores, stockées dans le cellier voisin. Voici les très belles restitutions proposées par Paul-François de ces équipements, et également une restitution du fonctionnement de l'édifice. D'après nos calculs, on pouvait, durant deux semaines de vendange, produire 1300 amphores de vin, ce qui correspond à une surface cultivée de 70 aroures. environ, c'est-à-dire une très grande surface. Les cavaliers clérouques, les plus hauts gradés de l'armée Lagide, recevaient environ 100 aroures. Le chai de Plinthine est le plus ancien des édifices de ce type en Égypte. Il est assez similaire à plusieurs édifices du monde grec, par exemple à Thasos ou encore en Chersonèse, et le pressoir qu'il comporte est une nouveauté apportée en Égypte par les colons grecs. Toutefois, l'édifice présente aussi le signe d'une adaptation aux pratiques vinicoles égyptiennes, avec la présence d'une très grande cuve au débouché du fouloir. Cette grande cuve n'est pas habituelle dans le monde grec, où le moût est, juste après son extraction, transvasé dans des pithoi pour y fermenter. Et c'est ainsi, assez certainement, une adaptation à la pratique égyptienne que l'on retrouve aussi dans la cuve du fouloir saïte que je vous ai montré tout à l'heure, de Plinthine, et sur les représentations qui figurent sur les parois des tombes Thébènes du Nouvel Empire, notamment le tombeau de Nakht. Ces cuves profondes sont probablement en lien avec une pratique égyptienne qui consistait à faire fermenter le vin dans la cuve, puis ensuite de le transférer directement en amphore. Une pratique encore mal comprise, mais qui est sans doute en lien avec le climat de l'Égypte. Qui sont les Grecs qui se sont implantés à Plinthine au début de l'époque hellénistique ? Pour le moment, rien ne permet de trancher, mais une fondation pour accueillir des clérouques est tout à fait possible. L'hypothèse d'une dôréa n'est pas non plus exclue, lorsque l'on sait que des grands domaines ont été attribués à des membres de la cour par Ptolémée II dans la région d'Alexandrie et du lac Maréotis. On pense ainsi qu'Apollonios lui-même, le ministre des Finances de Ptolémée II, aurait possédé un domaine constitué de jardins et de vignobles dans la région, qui semble tout aussi important que celui qu'il y possède près de Philadelphie. Il lui sert de paradis expérimental et il y fait cultiver des plants de vignes qui sont ensuite expédiés dans son domaine du Fayau. C'est ici le premier extrait de Papyrus. Vous voyez qu'Apollonios mentionne dans sa lettre à Zénon le fait qu'il va lui faire envoyer du territoire d'Alexandrie des cèpes de vignes en plus grand nombre encore. C'est également le cas d'un autre grand du royaume, Lysimachos, qui lui fait cultiver et adapter au sol égyptien des plants de figuiers, de grenadiers, d'abricotiers et des pieds de vigne dans sa propriété de la région d'Alexandrie. Et vous voyez que c'est extrêmement détaillé puisqu'il prend la peine de mentionner le fait qu'il enverra des pieds de vigne à raisins fumés, etc... C'est pour vérifier si le même type d'adaptation a été pratiqué à Plinthine que nous avons lancé récemment l'étude des restes de vignes et de pépins de raisins découverts à Plinthine dans les niveaux datés d'avant la conquête d'Alexandre et liés au fouloir saïte que je vous ai montré tout à l'heure et dans les niveaux associés au chai ptolémaïque. Ce projet, conduit par Clémence Pagnou en collaboration avec Charlène Bouchot et Ménat Eldori, permettra de déterminer si des changements ont porté sur les variétés cultivées à Plinthine et comment elles ont été, le cas échéant, adaptées aux terroirs égyptiens. Ce projet se fait dans le cadre plus vaste d'un programme qui réunit l'École française d'Athènes et l'IFAO, nommé VitiOrient, autour de la question des transferts techniques et biologiques dans le domaine de la viticulture au 1er millénaire avant Jésus-Christ. J'aimerais terminer maintenant en présentant une communauté de Grecs d'Égypte quelque peu différente de celle exposée jusqu'à présent. La mise en place du système des clérouquies en Égypte, qui permettait donc d'occuper et de récompenser les soldats en période de paix, a peut-être occulté un fait important, l'existence d'une armée professionnelle, même si le mot n'est pas du tout exact, œuvrant en Égypte même et non pas sur les terrains extérieurs. En temps de paix, tous les soldats en effet n'étaient pas démobilisés et n'étaient pas renvoyés sur leurs terres. Certains restaient en service actif sur le sol égyptien. Ils étaient par exemple campés dans des garnisons. D'autres étaient employés à des travaux d'intérêt général, notamment dans des mines et des carrières. D'autres, enfin, ont été impliqués dans une entreprise très originale, la chasse aux éléphants, sur laquelle les travaux de la mission du désert oriental ont permis de jeter une nouvelle lumière. Ces travaux ont porté sur la route ptolémaïque qui relie la ville pharaonique d'Edfou à Bérenice, le port fondé par Ptolémée II sur les rives de la mer Rouge vers 270 avant Jésus-Christ. Cette route a été empruntée à l'époque ptolémaïque dans un seul et unique but, celui d'alimenter le pouvoir lagide en éléphants de combat. Les pachydermes étaient chassés dans la corne de l'Afrique, vous voyez très au sud, dans le Soudan actuel, la région d'Adoulis, même vers le Bab el-Mandeb et sur la côte nord-est de la Somalie. Puis, ils embarquaient sur des navires à voile spécialement adaptés à leur transport et débarquaient dans le port de Bérenice, Bérenice-(...). Ils remontaient ensuite la route jusqu'à Edfou, avant d'embarquer sur le Nil en direction de Memphis. Ils étaient ensuite employés sur les champs de bataille côté Lagide, où ils affrontaient, tels des chars d'assaut, les éléphants indiens, désarmés des concurrents les plus directs des Lagides, les Séleucides. Ces éléphants ont laissé peu de traces malheureusement dans le désert oriental, enfin heureusement pour eux finalement, sauf un fragment de crâne mis au jour à Bérenice, dans le port de Bérenice, et un dessin, quelque peu sommaire, laissé par Dorion, un charpentier qui a participé à l'une de ses expéditions de chasse. Mais ils ont marqué les esprits, comme en témoignent ces vases en faïence ou encore ce moule à pain portant une représentation de l'animal. La route qu'ils ont empruntée a fonctionné des années 260 à 208-207 avant notre ère, avec des périodes d'abandon entre chaque expédition. On estime qu'entre 100 et 150 pachydermes ont transité par le désert, escortés par des milliers d'hommes et d'animaux. Pour leur permettre de traverser le désert sans encombre, la route, longue de 360 km, a été équipée à distance régulière de 12 stations, stathmoi, où elles pouvaient passer la nuit et trouver du ravitaillement en eau et en nourriture. Deux de ces stations ont été fouillées par nos soins. Celle d'Abbad est localisée au tout début de la route. Les caravanes de chasseurs s'y rassemblaient et y étaient approvisionnées avant de partir à l'assaut du désert. La station était pour cela équipée d'un puit, de trois citernes, d'une batterie de 12 fours à pain, d'une cuisine et d'au moins 4 pièces dédiées au stockage. En fouillant la station, nous avons découvert 13 ostracas, c'est-à-dire des textes écrits sur des tessons de poterie, qui ont servi de bons de distribution d'eau pour les membres de l'une de ces expéditions de chasse à l'éléphant de passage à Abbad. Les bons mentionnent que cette expédition comptait au moins 80 chasseurs, 120 machimoi pentarouroi, c'est-à-dire des clérouques de rang inférieur, peut-être cantonnés à des fonctions de garde, ainsi que 160 mistophoroi, des mercenaires, peut-être des rameurs de la flotte, ainsi que des guides et les âniers d'un char. En tout, au moins 528 personnes ont reçu de l'eau à Abbad. Mais l'archive est incomplète et l'expédition était sans doute encore beaucoup plus nombreuse, sans compter évidemment les animaux de bât qui devaient accompagner les hommes. Parmi les bénéficiaires des distributions figure Lichas, un officier de l'armée lagide bien connu des historiens puisqu'il est mentionné par Strabon et puisqu'il a laissé une inscription dans le temple d'Edfou, où il déclare fièrement qu'il a participé à deux expéditions en tant que stratège à la chasse aux éléphants. On peut situer ces deux expéditions dans les années 220 et 210 avant Jésus-Christ. Après trois jours de marche, et après être passé par deux stations intermédiaires, les membres de l'expédition atteignaient ensuite la station de Bir Samut, que nous avons également explorée. Il s'agit du plus grand édifice ptolémaïque du désert oriental, qui devait contenir une cinquantaine d'habitants permanents. Le centre de la cour accueillait un puits et une citerne, tandis que les pièces construites contre l'enceinte abritaient des lieux de vie, boulangerie et cuisine, ainsi que des pièces équipées de silos et d'autres dédiées au tissage. On comptait également un vaste entrepôt dans l'aile sud. Le bastion ouest accueillait un bain de type petit bain qui s'est développé en Égypte, preuve que les Grecs n'étaient pas prêts à renoncer, à ce luxe même en plein cœur du désert. Et d'ailleurs, des bains grecs ont été mis au jour dans toutes les stations routières fouillées par nos soins. De même que dans le port de Bérenice, puisque récemment nos collègues américains et polonais qui fouillent le port de Bérenice ont trouvé des bains à toloï dans le port ptolémaïque. Il est d'ailleurs prescrit dans une circulaire que vous avez ici à l'écran, envoyée aux responsables des stations de la route, de faire chauffer un bain pour l'arrivée d'un officiel de haut rang. Ce marqueur balnéaire est vraiment important et me semble démontrer que les Grecs d'Egypte n'ont pas renoncé à ce plaisir. La station de Bir Samut a été fouillée durant trois campagnes, qui ont livré un matériel fabuleux dont plus de 1200 ostracas dans les dépotoirs de Bir Samut. La moitié écrits en grec, l'autre en démotique. Il s'agit essentiellement de documents relatifs à la logistique de l'approvisionnement de la station et aux distributions d'eau et de nourriture. Ils nous font connaître des centaines de personnes, aussi bien de passage que travaillant au sein des stations, et donnent un aperçu, souvent bref, mais qui peut s'avérer très vivant, de la vie quotidienne au cœur du désert. L'anthroponymie et l'οnomastique des ostracas de Bir Samut a été récemment étudié par Laura Aguer, qui a réalisé sa thèse sur les ostracas grecs de la station. Cette onomastique est très variée et mêle des noms grecs, égyptiens et sémitiques. Les anthroponymes égyptiens sont plus nombreux chez les personnes chargées de la logistique, tandis que les personnes en charge du fonctionnement du système et les quelques soldats identifiés portent majoritairement des noms grecs. Parmi eux figure le corps particulièrement original des chameliers, à la tête desquels sont placés des chefs des chameliers, appelés chameliers royaux. Leurs anthroponymes, vous les voyez ici à l'écran, Artémidôros, Attalos, Barkaios, Hermophilos, et peut-être Inarous et Sôsipatros, sont tous grecs, sauf Inarous. Leurs fonctions et la manière dont ils apparaissent dans les ostracas les identifient à des officiers situés au sommet de la hiérarchie militaire. Mais ils n'étaient pas envoyés à la chasse à l'éléphant. Ils commandaient une troupe spécialisée formée de dizaines de chameliers qui, avec leurs chameaux, étaient chargés de convoyer eau et nourriture dans les stations de la route et ont formé la cheville ouvrière du bon fonctionnement du système. Il pourrait paraître étrange de voir des hellènes employées comme chameliers tant l'animal est éloigné, du monde grec est plutôt associé aux Perses ou aux populations nomades arabes, mais cela semble démontrer ici la grande adaptation des nouveaux arrivants à leur territoire, qui ont adopté l'animal des déserts pour mettre en place un système efficace de ravitaillement. Cela illustre aussi la souplesse de l'armée lagide, sa capacité à intégrer les personnes, mais aussi sa nature bigarrée et multiethnique. L'intégration va même au-delà et les populations nomades qui vivaient aux environs de la station de Bir Samut, sont-elles aussi intégrées au système de la route le temps des expéditions ? Deux populations distinctes sont mentionnées dans les ostracas, des trogodytes, qui sont appelées blemmyes dans les ostracas démotiques, une population d'origine africaine, qui participe au système en fournissant, par exemple, du petit bétail et peut-être une aide à guider les troupes au travers du désert. Ils reçoivent pour cela des rétributions, vous voyez que des trogodytes reçoivent ici de la bière. Les relations sont parfois tendues, ainsi que le démontre cet ostracon tout à fait vivant, en démotique, étudié par Marie-Pierre Chaufray, dont je vais lire simplement les premières lignes. Totomou salue Pachnoumis. Les blemmyes sont venus ici le soir du 30 Koyak. Ils devaient être 13. Ils ont frappé Panas en disant aboule du pain mais il ne leur en a pas donné. Quant à la seconde population, il s'agit d'Arabes. Ces Arabes sont intégrés dans le système de la route. en lien avec leur expertise en matière d'élevage de chameaux, qui est très recherchée. En témoigne ce document tout à fait exceptionnel publié par Hélène Cuvigny. Il s'agit d'un ordre adressé à un éleveur Amru, arabe du désert, comme il est spécifié dans l'Ostracon, de veiller à bien conduire les chamelles au pâturage pour qu'elles soient saillies par des mâles et pour ainsi assurer la naissance de chamelons dans les mois suivants. Le donneur d'ordre est Hermophilos, un chamellier royal. Tieus, son subordonné, est un égyptien, tandis qu'Abdos, un intermédiaire, porte un nom arabe. Enfin Radanos, malgré son nom grec, est sans doute un arabe lui aussi, peut être un interprète, d'après d'autres ostracas. Ainsi, la vie au sein d'une armée aussi mêlée, à son contexte, induit des contacts profonds entre les différentes populations représentées. Certes, les soldats restent et demeurent majoritairement grecs durant le premier siècle de la présence hellène en Égypte, mais l'armée, ses services logistiques, son intendance, comprend un nombre très important d'Égyptiens et même d'autres populations de l'Égypte dès les premiers jours de la présence grecque. On ne soulignera jamais assez le pouvoir d'intégration que l'armée a dû jouer et qui explique l'apparition d'une société largement multiculturelle en Égypte hellénistique, peut-être encore mieux que le système des clérouquies, et au même titre que d'autres espaces de cohabitation, de rencontres et de mixité, que ce soit au sein de l'appareil administratif ou dans les bains. Je voudrais terminer cette présentation en remerciant les membres des deux missions archéologiques dont les travaux ont largement été à la base de cette présentation, et vous remercie de votre attention.